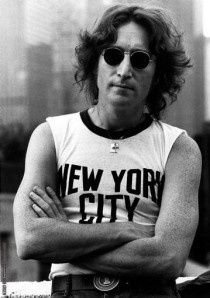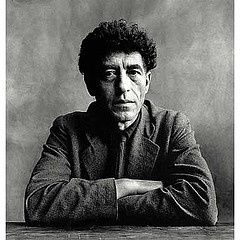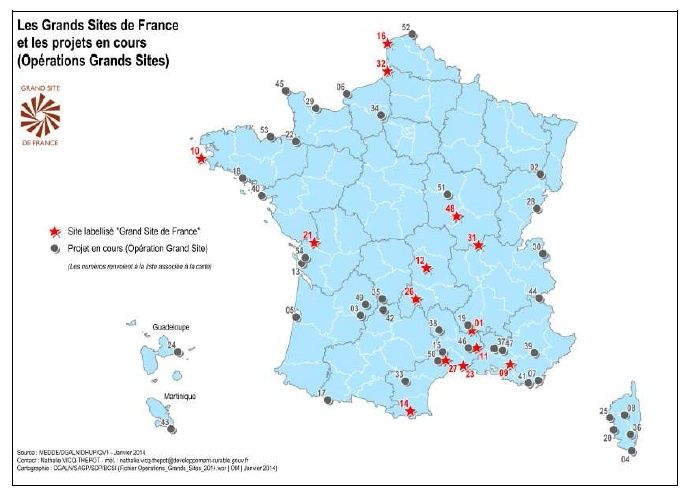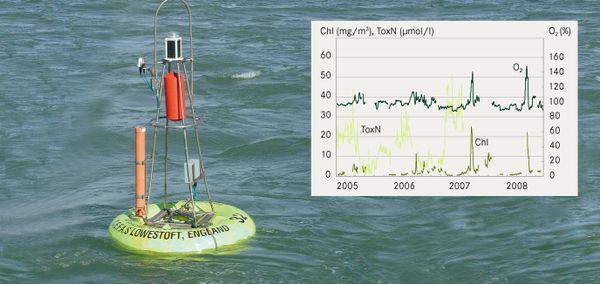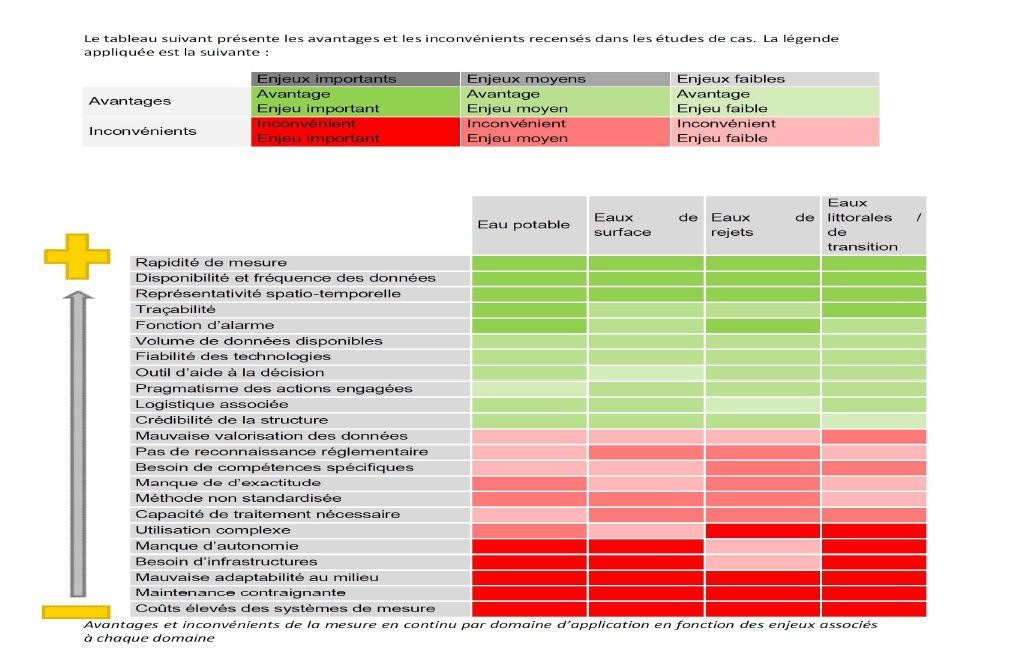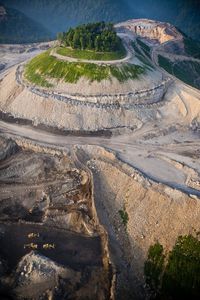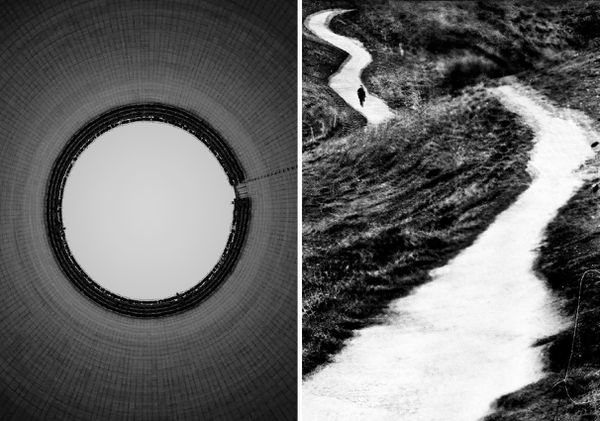Les Visions de Viollet-le-Duc à la Cité de l’architecture… à partir du 20 novembre
Du 20 novembre 2014 au 9 mars 2015
À l’occasion du 200e anniversaire de la naissance d’Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), la Cité de l’architecture & du patrimoine, avec la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, présente une exposition rétrospective de l’œuvre singulière de ce grand architecte, théoricien et restaurateur, fondateur du musée de Sculpture comparée dont le musée des Monuments français est l’héritier. L’exposition se déroule en sept séquences définissant les aspects de son travail et de sa personnalité.
Eugène Viollet-le-Duc est l'un des rares architectes du XIXe siècle dont les travaux de restauration et l’œuvre font toujours référence pour les professionnels de l'architecture, malgré des polémiques. Son génie a marqué de son empreinte l’histoire du patrimoine et de l’architecture du Moyen Âge. Longtemps, les historiens se sont attachés à mettre en perspective sa science archéologique, sa doctrine en matière de restauration et son activité au service du patrimoine. À partir des années 1970, les idées qu'il avait exprimées en matière de création architecturale furent à leur tour objet d’étude et de controverses. Aujourd'hui, trente ans après la dernière exposition monographique qui lui fut consacrée à Paris, ce sont les aspects les moins connus et les plus inattendus de cet artiste aux talents multiples qui sont présentés au public, pour témoigner de la richesse et de la complexité de sa personnalité. L’exposition dévoile ici le côté visionnaire de sa démarche et illustre l’alliance de positivisme et de délires romantiques, sources mêmes de son génie. Surgit peu à peu une personnalité étrange et complexe, hyperactive et féconde, mobilisant un savoir encyclopédique au service d’un projet politique tout autant qu’esthétique. Une figure majeure du XIXe siècle français.
Portrait(s)
Cette séquence donne corps au personnage par des portraits (sculptures, gravures et photographies) réalisés à diverses périodes de sa vie. Des documents restituent le contexte culturel et politique que l'architecte traverse de la Restauration jusqu’à la Troisième République. Ils livrent aussi une image de l’homme, fait d’évidente gravité et d’une fantaisie dont témoignent ses caricatures. On y retrouve son cercle familial, son entourage intellectuel mais aussi professionnel et politique comme Ludovic Vitet ou Prosper Mérimée. Viollet-le-Duc traverse un siècle marqué par une instabilité politique et sociale d’une rare intensité. Il laissera des témoignages de tous ces évènements, depuis les Trois glorieuses en 1830 jusqu’à son engagement au service de la Défense de Paris en 1870. Sa proximité constante avec les pouvoirs successifs pose la question de sa sensibilité ou de ses convictions politiques, de la sincérité de ses engagements. Viollet-le-Duc apparaît aujourd’hui comme un homme de réseaux dont la carrière n'aura connu aucune interruption dans un siècle mouvementé. Cette partie de l'exposition permettra aussi d’évoquer un quotidien fait d’habitudes, de goûts et de convenances sociales grâce à des documents d’archives, de la correspondance, des objets personnels, des livres de compte...
Le voyage, voir et rêver
Sa formation, non académique pour l’époque, est faite de voyages qui sont autant de parcours Initia- tiques dont il livre des impressions et des observations servies par un art consommé du dessin. Son journal de voyage et son abondante correspondance viennent éclairer, presque quotidiennement, ses découvertes. À la manière des voyageurs du Grand Tour du siècle précédent, il part en quête du Beau universel, du Beau idéal mais s'intéresse aussi à des périodes moins connues, comme le Moyen Âge et la Renaissance. Dans l’esprit du Romantisme contemporain, il se forge une idée de la « couleur locale », selon la formule de Prosper Mérimée, un patrimoine pittoresque, dépositaire des identités nationales. Le contexte romantique de la jeunesse de Viollet-le-Duc sera évoqué grâce aux personnalités qu'il a pu rencontrer.
Le voyage est aussi propice à rêver, à voir au-delà des réalités. Au Palais des Doges, à Venise, il perçoit les formes et les structures au-delà des murs ; à Rome, au Colisée, il redonne vie à l'édifice et assiste aux jeux antiques ; au-delà des ruines, il reconstruit en imagination le château de Pierrefonds.
Sur le chantier de la Sainte-Chapelle
Viollet-le-Duc décide très jeune de devenir architecte sans pour autant en suivre le parcours officiel. Son travail commence dans des agences comme celle de Jean-Jacques Huvé, mais il profite surtout de l'expérience acquise sur les premiers chantiers de restauration de monuments. Il livre ainsi des souvenirs émus de la Sainte-Chapelle de Paris, à la restauration de laquelle il participe en tant que second inspecteur des travaux à partir de 1840, auprès de Jean-Baptiste Lassus.
De la nature à sa métamorphose
Viollet-le-Duc manifeste un grand intérêt pour l’étude de la géologie, de la botanique, de l’anatomie et des sciences de la nature. Il y voit des figures étranges et fantastiques propres à nourrir ses réflexions et ses créations. Ses qualités de dessinateur, l’importance accordée à la précision et à la rigueur du trait sont fondatrices de sa pratique. En homme moderne, il saura faire usage des procédés de son époque pour gagner encore en précision. Grand amateur de montagne, il dresse ainsi une carte du Massif du Mont-Blanc toujours d’actualité.
Dans les études anatomiques, il trouve les clés de lecture et de compréhension des modèles structurels de l’architecture, presque vus comme des organismes vivants. Sa pratique du dessin d’architecture, reposant sur un registre de représentations très étendu, est liée à cette capacité de percevoir le squelette sous la peau.
Cette curiosité insatiable pour des matières et des domaines extrêmement variés, ce goût pour une certaine forme d'ésotérisme, d'étrangeté, le portent à s'intéresser aussi à d'autres civilisations et cultures lointaines (Mexique et arts précolombiens, Turquie et architecture islamique, Russie orthodoxe).
Le chantier de Notre-Dame de Paris
Ce chantier-phare du XIXe siècle est un éclatant manifeste des idées de Viollet-le-Duc en matière de restauration, de décoration et d’aménagement urbain. Sa vision globale de la restauration le conduit à formuler un projet portant sur l’édifice lui-même et ses abords (jardin, cloître, archevêché...). Viollet-le-Duc commence à mettre en pratique ses conceptions et théories de la restauration, celles qui lui font écrire dans son Dictionnaire raisonné que «restaurer un édifice, ce n’est pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné ».
Cette séquence présente une maquette exceptionnelle de la cathédrale Notre-Dame, réalisée en 1843, avant le début des travaux, qui permet de mesurer l’ampleur et la nature du travail accompli. L’architecte propose aussi une restitution des décors, extérieurs et intérieurs, depuis les grilles du chœur, la statuaire et les décors peints jusqu’au mobilier et à l’orfèvrerie liturgiques. De nombreux documents (études, planches, dessins à grandeur d'exécution, Journal des travaux, photographies, documents techniques...) et des œuvres réalisées (prêt exceptionnel d’objets conservés à Notre-Dame de Paris...) donnent corps à ce chantier. Son quotidien sera évoqué notamment à travers des compagnons et artisans (Ouradou, Denuelle, Geoffroy-Dechaume, Bellu, Gérente...) qui forment la petite armée de la restauration.
Un Moyen Âge retrouvé
Cette séquence décrit la manière dont Viollet-le-Duc réussit par ses études, ses publications et ses interventions, à faire émerger un patrimoine national et identitaire.
Viollet-le-Duc œuvre à reconstituer un Moyen Âge religieux, comme en témoignent les cathédrales de Bayeux et de Lausanne. Il participe aussi, par la conception de certains décors, à la mise en scène d’un decorum religieux autour de nouvelles figures de dévotion, comme à Amiens pour le retour des reliques de sainte Theudosie.
Son talent d’inventeur est également mis au service de l’architecture et du décor civils comme au château de Pierrefonds dont les décors intérieurs sont exemplaires par leur souci d’authenticité et d’unité de style. Cette capacité visionnaire et cette connaissance érudite de l’architecture médiévale le conduisent à définir et proposer des types architecturaux, aujourd’hui entrés dans l’imaginaire collectif comme le château-fort et la cathédrale idéale. Il n’hésite pas non plus à travailler pour ses contemporains et les wagons du train impérial de Napoléon III attestent de sa volonté de faire profiter ses commanditaires des inventions les plus modernes et les plus pratiques.
Un homme de pédagogie
Notoirement opposé à la manière dont sont enseignées l'architecture et l'histoire de l'art en France sous la férule de l'Académie et de l'École des beaux-arts, Viollet-le-Duc se consacre à la transmission de son savoir à l'intention d'un public professionnel et varié, voire des enfants. À l’aube de la IIIe République, Jules Ferry saura définir le projet de toute une vie, celui d’une nécessaire transmission du savoir, « d’une infatigable et triomphante défense des grands monuments de notre histoire contre le double vandalisme de la spéculation et de l’ignorance». (Éloge funèbre de Viollet-le-Duc par Jules Ferry, 1879).
L’enseignement et l’édition
Cette transmission a pu prendre la forme d’un enseignement comme celui des cours de dessin d’ornement qu’il dispense à la Petite école de dessin à partir de 1834, ou de son engagement au sein de l’École centrale d’architecture.
Elle a également pris celle de la publication d’ouvrages ayant connu une grande diffusion, aventure éditoriale hors du commun. Pour diffuser ses théories et ses modèles, Viollet-le-Duc publie notamment Le Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle (10 volumes, 1854-1868) ou le Dictionnaire raisonné du mobilier français de l’époque carolingienne à la Renaissance (8 volumes, 1858-1875). Il écrit également des ouvrages à l’intention de la jeunesse, tous les volumes Histoire de..., publiés par Hetzel, l'éditeur des œuvres de Jules Verne.
Le musée de Sculpture comparée
Dès 1848, il conçoit le projet d’un musée de repro- ductions de sculptures, expression de ses théories sur l’évolution de la sculpture médiévale française. Ce projet entend matérialiser, en volume et à échelle, le travail de sélection et de classification à la base même de son œuvre. Le musée de Sculpture comparée affirme la valeur de ce patrimoine national, par un discours historique et stylistique destiné à le faire connaître et reconnaître par tous. Le musée verra le jour, en 1882, après la mort de l’architecte. Cette séquence décrit le musée sur le mode de la reconsti- tution de deux de ses salles : la méthode comparatiste appliquée à la sculpture de la Renaissance et la mise à disposition typologique d'un répertoire de formes dans la salle d'ornementation (XIIe- XIIIe siècles). C’est ainsi que nous devons à Viollet-le-Duc la galerie des moulages de la Cité de l’architecture & du patrimoine, elle-même héritière des missions que s’était donné l’architecte de diffuser la culture architecturale auprès des professionnels et du grand public.
InformatIons pratIques
Cité de l’architecture & du patrimoine
Galerie des expositions temporaires
1 place du Trocadéro Paris, 16e
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 11h à 19h le jeudi jusquʼà 21h
Plein tarif : 9€/TR: 6€