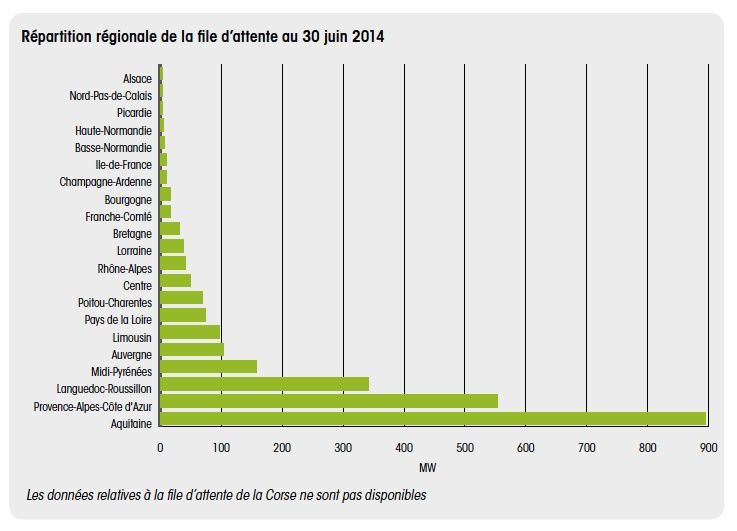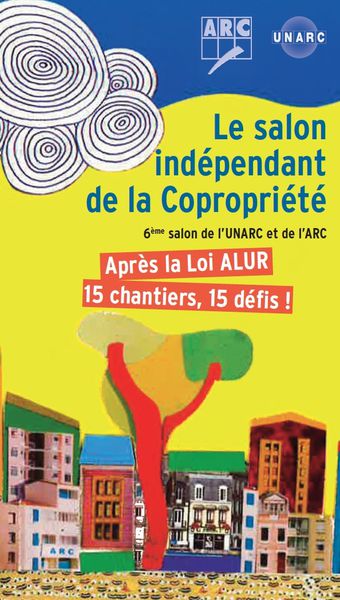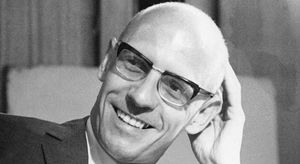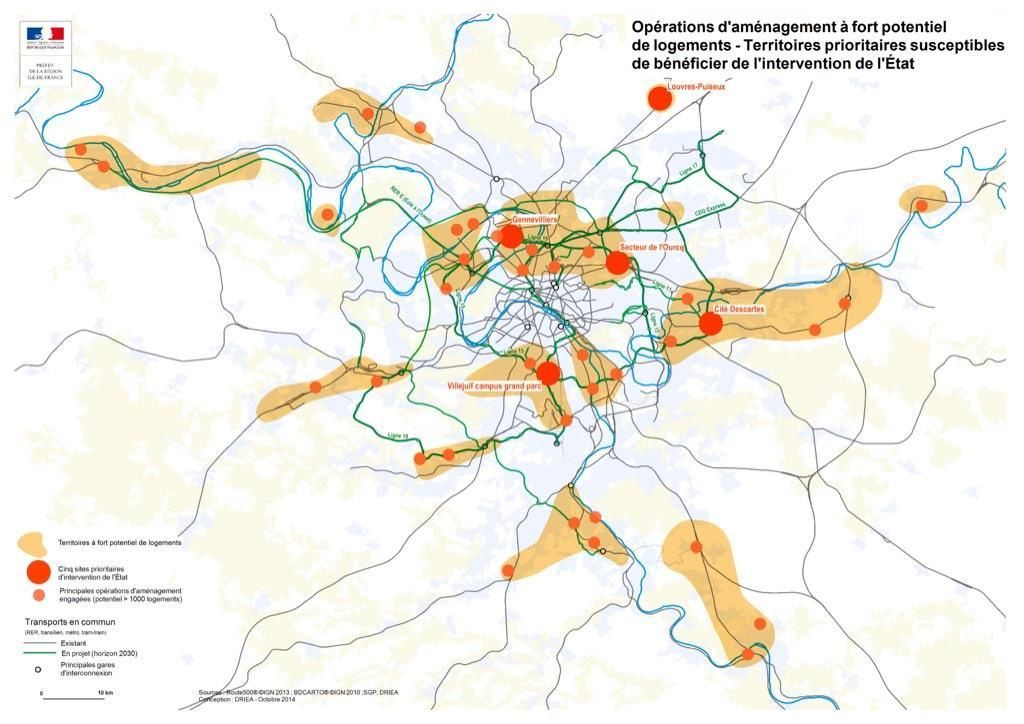À la centrale nucléaire de Cattenom, un dispositif crucial pour la sûreté absent depuis la construction !
Fin 2011, EDF a constaté l’absence de dispositif casse-siphon sur les tuyauteries de refroidissement des piscines d’entreposage des combustibles des réacteurs 2 et 3 de la centrale de Cattenom. Ce dispositif permet d'éviter que l'eau des piscines ne se vide, laissant alors le combustible à l'air libre et non refroidi. Il est scandaleux que l'exploitant n'ait constaté cette absence qu'en 2011 alors même que ces casse-siphons manquent à l'appel depuis la construction des piscines, soit depuis près de 30 ans ! Le Réseau "Sortir du nucléaire" a déposé une citation directe à l’encontre d’EDF. France Nature Environnement et MIRABEL Lorraine Nature Environnement se sont constituées parties civiles. L’audience aura lieu le 7 octobre 2014, à 14h, au Tribunal correctionnel de Thionville.
À la centrale nucléaire de Cattenom, un dispositif crucial pour la sûreté absent depuis la construction !
Dans chaque réacteur nucléaire, une piscine est destinée à l’entreposage du combustible dans l’attente de son utilisation dans le cœur du réacteur ou de son évacuation : en effet, celui-ci doit être maintenu sous eau et refroidi en permanence.
L’eau de refroidissement est injectée au fond de la piscine par une tuyauterie. En cas de manœuvre incorrecte, la tuyauterie d’injection pourrait aspirer l’eau de la piscine par un phénomène de siphon, au lieu d’en injecter, ce qui conduirait à une baisse considérable du niveau de l’eau. Cette tuyauterie est donc normalement dotée d’un orifice appelé "casse-siphon, destiné à enrayer un siphonage qui se serait amorcé.
Or, sur le site de Cattenom, à 5 km de Thionville et 10 km du Luxembourg et de l’Allemagne, lors d’un contrôle effectué dans le cadre des réexamens de sûreté post- Fukushima, EDF a constaté l’absence de dispositif casse-siphon sur les réacteurs 2 et 3 de la centrale de Cattenom, et ce depuis la construction des piscines d'entreposage !
Un manquement grave déclaré tardivement
Pendant plusieurs décennies, en l’absence de ce dispositif, seule la chance a empêché le déclenchement d’un siphonage, qui aurait pu survenir par une simple mauvaise manipulation de certaines vannes. Cette non-conformité est suffisamment grave pour que l’Autorité de sûreté nucléaire consente à classer le problème au niveau 2 de l’échelle INES, correspondant à un « incident assorti de défaillances importantes des dispositions de sécurité ».
L'exploitant a constaté ce grave problème le 21 décembre 2011. Pourtant, il ne l’a déclaré dans les formes prescrites que le 18 janvier 2012, soit plus de 28 jours après : il est vrai qu'après 30 ans d'absence, on n'est finalement plus à quelques jours près ! Pourtant, la réglementation relative aux installations nucléaires de base impose une obligation de déclaration sans délai. Sa violation est constitutive d’un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le Réseau "Sortir du nucléaire" a porté plainte pour dénoncer ces graves négligences. Cette plainte ayant été classée sans suite, il a fait citer directement EDF devant les juridictions de jugement. France Nature Environnement et MIRABEL Lorraine Nature Environnement se sont constituées parties civiles. L’affaire sera examinée par le Tribunal correctionnel de Thionville, le 7 octobre 2014, à 14h. Les trois associations appellent à se rendre au tribunal, mardi après-midi, et à assister à l’audience.