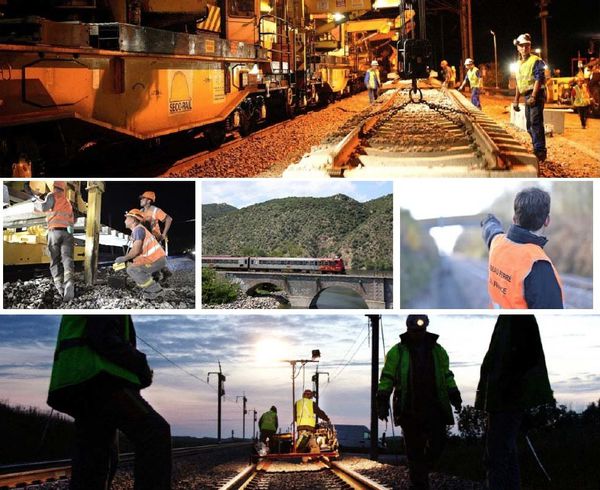Retour sur 2013 et perspectives pour 2014, le rapport d’activité du Plan Bâtiment Durable fait le point :
Le Plan Bâtiment Durable a publié son rapport d’activité 2013 qui retrace les phases clés de 2013 et liste perspectives pour 2014.
2013, année dynamique pour le Plan Bâtiment Durable autant pour le neuf que pour la rénovation selon Philippe Pelletier marquée au niveau gouvernemental par l’annonce et la mise en place de différents programmes structurants pour l’atteinte des objectifs d’efficacité énergétique dans le bâtiment comme :
- le Plan d’investissement pour le logement,
- le débat national pour la transition énergétique,
- le lancement de la nouvelle France industrielle,
- la phase opérationnelle du programme de rénovation énergétique de l’habitat,
- la deuxième conférence environnementale,
- l’engagement de la démarche « Objectifs 500 000 ».
Si pour le Plan Bâtiment Durable, l’année 2013 symbolise l’entrée d’une nouvelle ère, 2014 devra confirmer l’élan. Si le bâtiment représente 43% de l'énergie consommée en France, la facture énergétique continue de progresser, le Plan Bâtiment Durable insisté sur l'importance de la transition énergétique et de la Directive énergétique adoptée en octobre 2012, dont la prochaine grande étape est la "réalisation et la transmission de la stratégie à long terme pour l'après-2020, destinée à mobiliser l'investissement dans la rénovation". L'objectif est d'établir, avant avril 2014, une stratégie de long terme pour organiser la rénovation énergétique du parc tertiaire et résidentiel, précise le rapport.
Les fondamentaux de la RT 2012 :
Effectuant un large panorama depuis la mise en place du grenelle de l’Environnement et les ambitions en matière d’efficacité énergétique, le rapport revient sur l’entrée en vigueur généralisée de la RT 2012.
La nouvelle réglementation qui divise presque par trois les exigences par rapport à la RT 2005 constitue une avancée sans précédent. Ainsi pour le Plan Bâtiment Durable, la RT 2012 offre une réelle liberté de moyens dans l’atteinte d’une performance énergétique définie. Installée durablement, la RT 2012 doit être accompagnée de labels. L’entrée en vigueur généralisée de la RT 2012 marque la disparition des labels BBC fondés sur la RT 2005. Tout au long des années 2012 et 2013, une large consultation a donc été engagée par l’administration afin de définir les prochains labels réglementaires fondés sur la RT 2012.
Deux niveaux de labels sont envisagés : « haute performance énergétique » (HPE) et « très haute performance énergétique » (THPE), et s’inscrivent dans une logique de diminution progressive de la consommation d’énergie primaire.
Ces labels, qui devaient être publiés courant 2013, font encore, début 2014, l’objet de discussions et de concertations afin de répondre aux problématiques de l’ensemble de la filière, et notamment des maîtres d’ouvrage.
Dans le même temps, le collectif Effinergie a développé un label volontaire « Effinergie + » dont les premières opérations ont émergé en 2013, ainsi qu’un label Bepos-Effinergie.
A travers le thème de la construction durable, le Plan Bâtiment Durable a donc institué un groupe de travail chargé de livrer une vision prospective de la réglementation à l’horizon 2020. Co-piloté par Christian Cléret (directeur général de Poste Immo et directeur immobilier du groupe La Poste) et Bernard Boyer(président de Sun BBF et S2T), le groupe de travail est intitulé « Réflexion Bâtiment Responsable 2020-2050 » : il ambitionne ainsi de livrer une vision prospective qui s’inscrive dans le temps long. Un premier rapport publié à l’été 2012, et enrichi des contributions d’une journée de réflexion avec les acteurs de la filière, avait révélé une approche innovante à travers un regard croisé : Hommes, Temps et Territoires.
En effet, le groupe défend l’idée que l’émergence de bâtiments « responsables », n’est possible que si l’usager et le citoyen sont remis au cœur de la réflexion, si le bâtiment est pensé en synergie avec son environnement et s’il est considéré en fonction de sa résilience et de son cycle de vie.
Les réflexions 2013 : Tout au long de l’année 2013, le groupe de travail a bénéficié de contributions et éclairages de différents acteurs du bâtiment et de l’énergie, ce qui lui a permis d’enrichir sa réflexion et de développer certaines thématiques, et l’a conduit à publier un nouveau rapport à l’été 2013.
Intitulé « Embarquement pour un bâti sobre, robuste et désirable», le rapport s’articule autour de plusieurs pistes de réflexion :
1. Penser décentralisé
2. Penser territoire et global
3. Penser contenu et usages
4. Penser opportunité et innovation industrielle
5. Former des acteurs responsables et solidaires
6. Mettre en mouvement les acteurs
Tout au long de l’année 2014, le groupe de travail, par l’intermédiaire du blog et de nouvelles auditions, va enrichir sa réflexion et confronter ses idées. Un colloque se tiendra à la fin du 1er semestre 2014 avant que les propositions soient présentées aux pouvoirs publics, permettant aussi d’enrichir le projet de loi pour la transition énergétique.
Concernant le grand volet de la rénovation, le Plan Bâtiment Durable livre les actions du gouvernement notamment dans le cadre du plan d’investissement pour le logement (PIL), le plan de rénovation énergétique de l’habitat (PREH) qui décline un ensemble d’actions destinées à répondre à l’engagement présidentiel de rénover 500 000 logements par an d’ici 2017 : 120 000 logements sociaux et 380 000 logements privés.
En avril dernier, l’équipe du Plan Bâtiment Durable, en lien avec la rédaction du Moniteur, a organisé un événement sur le thème : "La rénovation énergétique des logements : comment accompagner les ménages?". Plus de 150 personnes étaient présentes.
A partir d’un recensement des initiatives portées par des collectivités locales, des entités privées ou des partenariats multiples, l’événement a permis de présenter une dizaine d’initiatives de guichets uniques et d’offres intégrées, reflétant ainsi la diversité des modèles possibles. Un débat a ensuite permis de croiser les regards, d’identifier les forces et les faiblesses de chacun des modèles. Un fascicule répertoriant plus de 50 de ces initiatives a été édité à cette occasion.
Sur le thème de la précarité énergétique, le Plan Bâtiment Durable rappelle que 87 % des ménages en situation de précarité énergétique sont logés dans le parc privé. Que 79 % des Français considèrent l’énergie comme un sujet de préoccupation important (vs. 70% en 2010). Et enfin, que 44 % des foyers ont restreint leur chauffage au cours de l’hiver 2012/2013 pour ne pas avoir de factures trop élevées. Sur la base des propositions portées par le Plan Bâtiment (janvier 2010) et du consensus de l’ensemble des acteurs impliqués dans l’accompagnement des ménages modestes ou en situation de précarité énergétique, le programme « Habiter mieux » a été créé. Porté par l’Agence nationale de l’Habitat (Anah), le programme constitue le volet «lutte contre la précarité énergétique» du plan de rénovation énergétique de l’habitat et de la campagne . Il vise à aider, d’ici 2017, 300 000 ménages à sortir de la précarité énergétique en les accompagnant dans la définition, le financement et la réalisation des travaux de rénovation énergétique de leur logement. C’est une action pérenne, complémentaire des aides au paiement des factures, qui agit ainsi directement sur la réduction des dépenses d’énergie liées au logement. Après une montée en charge progressive sur l’année 2012, le programme s’est accéléré en 2013. 31235 logements ont fait l’objet de travaux de rénovation énergétique sur le territoire métropolitain et se répartissent comme suit : 27 530 propriétaires occupants, 2 150 propriétaires bailleurs et 1 555 logement situés dans une copropriété en difficulté ont été aidés. Le Plan Bâtiment Durable précise que l’accélération u programme est très satisfaisante, elle permet de s’inscrire dans la trajectoire pour atteindre l’objectif de 300 000 ménages aidés d’ici 2017. Toutefois, cette dynamique suppose que l’ensemble des opérateurs et acteurs sociaux soit en mesure d’absorber cette hausse spectaculaire de la demande et des dossiers. Il convient donc d’être vigilant sur ce point.
Concernant la problématique du financement, le rapport souligne que la rénovation énergétique des logements privés est encore ralentie par les complexités de fonctionnement de l’éco-prêt à taux zéro. Ainsi, on estime à moins de 30 000 le nombre de prêts réalisés sur l’année 2013, là où la première année de distribution avait permis la réalisation de plus de 80 000 prêts.
Pour le Plan Bâtiment Durable, la dynamique devrait toutefois être renforcée en 2014 par les effets conjugués de la campagne de communication « J’éco-rénove, j’économise » et le déploiement du PREH.
De plus, la simplification de la distribution de l’éco-prêt devrait trouver une traduction opérationnelle en 2014.
Par ailleurs, l’annonce du Gouvernement de l’entrée en vigueur du principe d’Eco-conditionnalité des aides publiques au 1er juillet 2014 pour l’éco-prêt à taux zéro, et au 1er janvier 2015 pour le crédit d’impôt développement durable, constitue une étape importante dans le attendue par tous le secteur. Tout au long du 1er semestre, l’équipe du Plan Bâtiment Durable suivra avec vigilance sa préparation.
, le rapport note l'obligation d'un audit énergétique (arrêté du 28 février 2013), ainsi que le projet de loi ALUR (loi pour l’accès à au logement et à un urbanisme rénové) qui devrait encore faciliter la rénovation énergétique des logements en copropriété.
Le projet de loi, non encore définitif au jour où ce rapport est publié , prévoit d’abaisser la majorité requise pour les votes de travaux de rénovation (la majorité simple serait requise), d’élargir l’obligation de diagnostic à la création d’un diagnostic technique global (en plus du DPE ou audit énergétique, une analyse de l’état apparent des parties communes et de leurs équipements et un état de la situation au regard des obligations légales et réglementaires ainsi qu’une analyse des améliorations possibles.
Le diagnostic global sera mis à jour tous les 10 ans, sa réalisation sera obligatoire avant le 1er janvier 2017).
Le projet prévoit aussi la création d’un fonds de prévoyance pour financer la rénovation énergétique des copropriétés, et l’allégement des règles de majorité pour décider de surélever l’immeuble collectif.
De plus, le Plan Bâtiment Durable précise que pour financer les travaux d’économies d’énergie en copropriété, les conventions de distribution de l’éco-prêt à taux zéro collectif doivent être signées début 2014, rendant sa distribution effective.
L’équipe permanente du Plan Bâtiment Durable suit avec attention les travaux initiés sur la copropriété au sein des différentes instances, notamment au sein de l’association APOGEE.
Un « rendez-vous du Plan Bâtiment Durable » sera consacré au printemps aux initiatives de sensibilisation et de formation des acteurs de la copropriété et une action forte de mobilisation de la filière sera proposée au cours du 1er trimestre.
Sur le Parc social, le Plan Bâtiment Durable estime que les acteurs du parc social s’impliquent résolument dans l’entretien et l’amélioration de leur parc de logements, ce qui leur permet d’être également particulièrement mobilisés dans le mouvement de rénovation énergétique.
En conséquence, les 4,5 millions de logements sociaux, avec une consommation moyenne de 170 kWep/m2.an, ont un niveau de performance énergétique meilleur que le reste du parc résidentiel. Toutefois, le Plan Bâtiment Durable va rester attentif au déploiement d’un pacte d’objectifs et de moyens conclu en juillet 2013 entre l’Etat et le mouvement HLM qui prévoit la rénovation énergétique de 120 000 logements sociaux par an et à mettre en place des dispositifs d’accompagnement des ménages après travaux afin de lutter contre l’effet « rebond » et à la distribution de l’éco-PLS. Il sera également attentif à la problématique de l’amiante pour lesquels les coûts engendrés sont importants et impactent lourdement les investissements en matière d’efficacité énergétique.
Comprendre le taux de l’éco-PLS Le taux est désormais fixé :
- au taux du livret A diminué de 75 points de base pour une durée du prêt inférieure ou égale à 15 ans ;
- au taux du livret A diminué de 45 points de base pour une durée du prêt supérieure à 15 ans et inférieure ou égale à 20 ans ;
- au taux du livret A diminué de 25 points de base pour une durée du prêt supérieure à 20 ans et inférieure ou égale à 25 ans.
Autre problématique soulevée, celle de l La question de l’opportunité d’une obligation de rénovation énergétique dans le parc résidentiel avait été posée par le Comité opérationnel du Grenelle de l’Environnement sur les bâtiments existants (conduit par Philippe Pelletier – Février 2008). Un chantier important a été lancé en 2013 avec la création d’un groupe de travail chargé d’explorer l’opportunité et les modalités d’une obligation future de rénovation dans le secteur résidentiel. Mené par Jacques Chanut (vice-président de la FFB) et Raphaël Claustre (CLER), le groupe de travail a établi un rapport dans lequel la question d’une obligation n’est pas tranchée. En toute objectivité, il explore tous les leviers identifiés sans les juger, ouvre des pistes de réflexion, formule des propositions partagées par tous et évoque les sujets qui divisent.
En préalable, le rapport souligne le caractère insoutenable de la situation actuelle avec une atteinte difficile des objectifs, la nécessité d’envisager une stratégie de long terme et d’agir impérativement sur le champ de la rénovation énergétique du parc résidentiel, et enfin l’importance d’améliorer la structuration de la filière de l’offre de service.
Ensuite le rapport constate qu’il n’existe pas d’accord sur la possibilité de mettre en œuvre une obligation généralisée de travaux, sachant que la notion même d’obligation recouvre des acceptions et des champs très variés.
Les principaux points d’accord du rapport « Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel »
· la nécessité d’une politique incitative plus lisible, plus large et plus exigeante en terme de performance, qui passe par une remise à plat des outils existants,
· une indispensable réforme du DPE,
· le constat que dans bien des cas, la réalisation de travaux de rénovation énergétique se heurte, s’agissant en particulier d’isolation par l’extérieur mais pas seulement, à des obstacles juridiques qu’il faut identifier et résoudre,
· la mise à jour de la réglementation thermique dans l’existant,
· la création, au sein des copropriétés, d’un fonds travaux obligatoire.
Si les contributions du groupe de travail sur l’exploration d’une telle obligation n’ont pas dégagé de consensus, elles ont permis toutefois de marquer des points d’accord évidents et particulièrement la nécessité « d ’embarquer la performance énergétique » chaque fois que cela est possible, c’est à dire, saisir l’occasion de travaux sur l’immeuble pour y associer une action de rénovation énergétique.
A cet effet, le Plan Bâtiment Durable va suivre avec attention les travaux préparatoires de la loi pour la transition énergétique, qui devrait contenir des éléments relatifs à l’évolution de la RT dans l’existant.
Enfin sur le parc tertiaire public et privé, avec plus de 922 millions de m2 de surfaces chauffées en 2010 (source : CEREN, chiffres clés du bâtiment 2011 – ADEME), une grande hétérogénéité de bâtiments et une consommation énergétique très diverse selon l’utilisation, l’ensemble du parc tertiaire représente un important d’économies d’énergie aux problématiques.
A la différence du parc résidentiel qui ne fait l’objet d’aucune norme coercitive de travaux, le secteur tertiaire public et privé présente la spécificité d’être astreint à une obligation de travaux d’amélioration de la performance énergétique.
En effet, l’article 3 de la loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, dispose que « des travaux d’amélioration de la performance énergétique seront réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exercent une activité de service public dans un délai de 8 ans à compter du 1er janvier 2012 ».
Un décret d’application doit déterminer la nature et les modalités de cette obligation de travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter « en tenant compte de l’état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique ».
Dès lors, au printemps 2013, constatant l’absence à court terme du décret d’application, le Plan Bâtiment Durable a porté l’idée d’une action volontaire de l’ensemble des acteurs afin d’engager la rénovation énergétique du parc tertiaire public et privé.
Les perspectives en 2014 devraient apporter de nouvelles signatures de la charte notamment sous l’impulsion de l’Observatoire de l’Immobilier Durable, de Bureau Veritas et de France GBC. Des acteurs publics devraient également rejoindre plus largement la démarche, à l’initiative notamment du Conseil général de l’Essonne.
Tout au long de l’année, l’équipe du Plan Bâtiment Durable va favoriser l’accueil de nouveaux acteurs publics et privés.
Les principaux points de méthodes de la charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés
Mobiliser les trois leviers principaux d’action : évolution des comportements, amélioration de l’exploitation et de la maintenance, travaux de rénovation du bâti ou des équipements ;
Fixer l’objectif de performance à atteindre, en tenant compte du niveau de performance initiale et des travaux déjà réalisés, en visant une réduction de la consommation énergétique d’autant plus élevée que la performance de départ est faible ;
Apprécier les efforts de réduction de la consommation rendue possible par la coopération de toutes les parties prenantes, soit immeuble par immeuble, soit à l’échelle du patrimoine dans son ensemble ;
Prendre en compte le caractère rentable et soutenable des investissements réalisés ;
Cibler l’effort en écartant du périmètre immobilier concerné certains bâtiments du fait soit de leur surface, soit de leur statut juridique en copropriété, soit de leur destination particulière.
Les signataires s’engagent à porter l’effort sur les bâtiments de plus de 1000 m2 et peuvent, s’ils le souhaitent, prendre en compte les surfaces plus petites.
Sur la base des travaux initiés fin 2013, le cadre d’élaboration des plans de progrès et le reporting sera communiqué début 2014 aux signataires de la charte.
Le comité de pilotage sera constitué et réuni au cours du 1er trimestre 2014.
Après de premiers échanges fin 2013, les travaux avec les différents réseaux consulaires devraient s’engager début 2014.
L’année 2014 doit permettre le recueil du plus grand nombre d’expériences afin d’y appuyer la rédaction du projet de décret.
Par ailleurs, sur la recherche de financement innovants de l’efficacité énergétique, le Plan Bâtiment Durable fait savoir que 2014 devrait être l’année de création du fonds de garantie porté par la CDC mandatée par le premier ministre pour poursuivre ses travaux.
Les financements européens du FEDER seront prochainement décidés et organisés pour la nouvelle période 2014-2020. Outre le soutien maintenu aux bailleurs sociaux, ils pourraient être fléchés partiellement vers les logements privés, dès lors qu’ils permettent la création de mécanismes financiers innovants.
Les innovations portées par des collectivités territoriales, notamment en termes de tiers financement et de services publics de l’efficacité énergétique, continueront de se déployer.
La loi transition énergétique devrait conduire à renforcer les dispositifs de financement de la rénovation.
L’équipe du Plan Bâtiment Durable sera attentive à toutes ces questions.